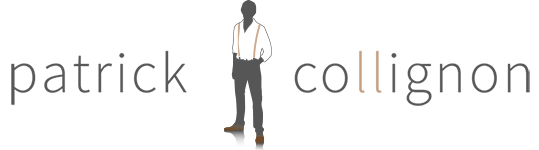Combien de fois par jour vous dit-on : « oui, mais… » ? Et « mais », genre : « j’ai envie, mais ce n’est pas le moment » ? Quel effet ça vous fait, tous ces « mais » dans votre vie ? Est-ce un plus ou est-ce un moins ? Découvrez 5 attitudes constructives face au mais…
« Non, peut-être » et « oui, mais »
Les Bruxellois ont une manière particulière de dire : « oui ». Ils disent : « Non, peut-être ? » Comme dans : « Il était chouette ce film ? » ; « Non, peut-être » ! Alors, quand on leur dit : « oui, mais », ils savent instinctivement que ça veut dire « non »…
Dans une conversation (ou un monologue), le « mais » est un mot à la fonction particulière : il introduit une idée contraire à celle qui vient d’être exprimée, la corrige, la précise, la restreint. Il l’efface, comme une objection dans un tribunal… « Mais » est un mot tellement peu constructif qu’il est banni du théâtre d’improvisation (dixit Cécile H., Commentant mon Brainhack 3) car il ne crée aucun lien avec la phase précédente, qu’il tue…
Vous recevez des « oui, mais »…
Vous êtes en train d’exprimer quelque chose. Vous n’avez pas fini votre phrase que votre interlocuteur vous dit : « oui, mais »… Pénible, non ? Ça vous donne l’impression qu’il n’a pas envie d’écouter ce que vous venez de dire, autocentré qu’il est sur son seul point de vue. Et puis, son intervention dévie la conversation. En plus, souvent, vous avez envie d’argumenter pour dire : « mais si » !
Difficile de poursuivre sur sa lancée sans se laisser happer par une guerre de tranchées d’arguments et de contre-arguments qui s’empilent sans finalité dans un véritable dialogue de sourds. Cette « guerre » en est, symboliquement, une : la manière de voir les choses de votre interlocuteur s’oppose à la vôtre. Et il vous le fait savoir. Qui va gagner ?
Vous, désormais !

Ne dérapez pas dans les conversations : tenez votre cap!
Rien de personnel…
Un « oui, mais » n’arrive jamais par hasard. Il a une fonction. Et ce n’est pas celle de vous faire taire ! Généralement, les spécialistes des « oui, mais » ont des mobiles cachés :
- Ils ont besoin qu’on reconnaisse leurs mérites (prudence, sagesse, connaissances…).
- Vous les amenez sur un terrain où ils ne se sentent pas à l’aise, alors ils reviennent sur leur terrain.
- Ils ont besoin d’avoir le « lead » de la conversation.
- Ils ne supportent pas que vous fassiez ce qu’eux-mêmes s’interdisent.
- Ils ne supportent pas que vous preniez trop de place.
- Ils ont besoin de tenir le crachoir pour se sentir exister.
- Ils tiennent à rester dans leurs habitudes de réflexion/de vie et ne souhaitent pas être challengés ou bousculés.
- Ils ont besoin qu’on les plaigne et ne cherchent pas nécessairement de solution…
- Ils s’identifient à vous et imaginent déjà les obstacles qu’ils devraient franchir à votre place…
Nouvelles attitudes
Première attitude : ne pas prendre personnellement ce : « oui, mais ». Il concerne surtout la personne qui l’émet…
Deuxième attitude : ne pas se laisser embarquer dans un argumentaire qui vous éloigne de votre sujet. En d’autres termes, prendre note du : « oui, mais » et remercier votre interlocuteur (ainsi, vous prenez soin de son besoin de reconnaissance)… Et poursuivre ce que vous étiez en train de dire.
Troisième attitude : vous rappeler (et rappelez peut-être votre interlocuteur) qu’on peut facilement remplacer « oui, mais » par « et ». Dans la vie, deux réalités peuvent coexister sans s’affronter nécessairement, pas vrai ?
Quatrième attitude : si les « oui, mais » s’enchaînent, se demander si vous êtes accueillis et écoutés avec suffisamment de qualité. Peut-être n’est-ce pas le moment et vaut-il mieux différer votre discours ? Peut-être votre interlocuteur n’est-il pas la personne adéquate pour ce que vous avez à dire… et y gagneriez-vous à trouver quelqu’un d’autre ?
Un « mais » difficile à digérer
On constate aussi, en développement personnel, que le « oui, mais » a une fonction : celle d’empêcher quelqu’un de prendre un risque, de sortir de sa zone de confort et, surtout, de changer ou de remettre en question quoi que ce soit. Surtout ce qui pourrait ramener l’émetteur du « mais » à ses propres manquements, carences, envies frustrées ou rêves oubliés…
Au final, tous les « mais » que l’on sert aux autres ne sont que des « mais » que l’on se sert à soi-même… Pour se convaincre, peut-être, que tous les rêves et toutes les libertés auxquels nous avons renoncés.
Dans la vidéo suivante, vous trouverez un petit truc pour ne plus renoncer à ce qui vous fait envie, ce qui vous plaît, ce qui vous donne du plaisir ou de l’énergie…
Je vous invite à consommer cette astuce sans modération…
Belle semaine !
Patrick